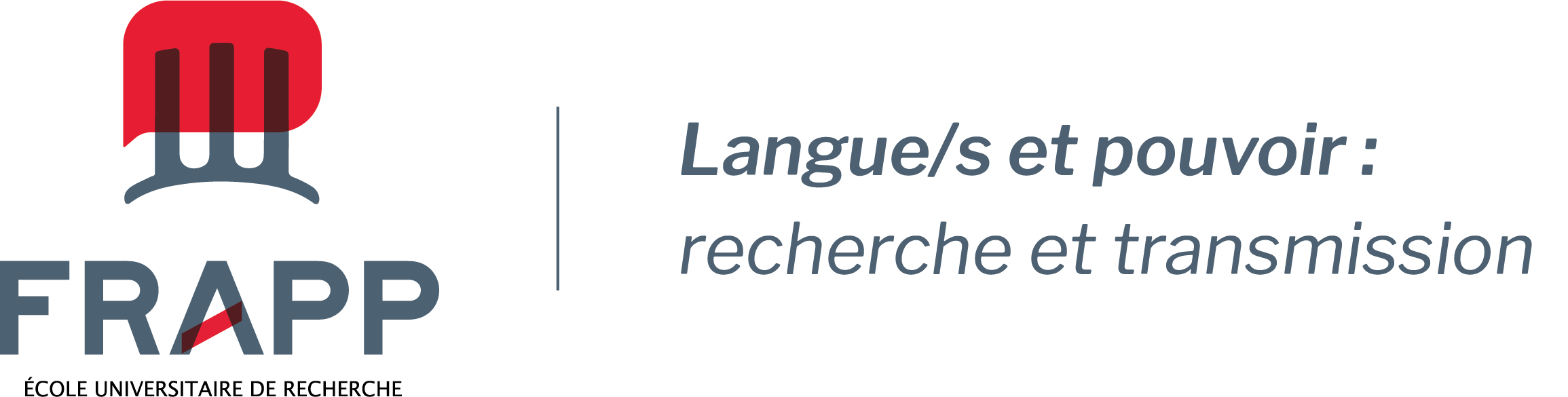Sylvie Kandé est une poétesse et historienne française d’origine franco-sénégalaise. Ses travaux portent sur l’histoire africaine et la littérature francophone (africaine et caribéenne) qu’elle enseigne à New York, où elle vit depuis 1987. C’est en s’appuyant sur sa double expérience de poétesse et d’historienne qu’elle a évoqué le thème du festival, « Territoires », mettant ainsi en lumière sa conception de la poésie et de l’écriture poétique. Nous vous proposons de découvrir les principaux passages de son intervention.
La notion de « territoire »
Interrogée sur la notion de territoire, Sylvie Kandé rappelle en premier lieu qu’elle est fondée sur un « scandale » (Jean-Jacques Rousseau) dans la mesure où le territoire constitue l’appropriation par un petit nombre de ce qui appartient à tous. Cette appropriation s’accompagne dans l’histoire d’un discours de légitimation. L’intention poétique s’oppose à cet égard aux « cruautés du langage » (Stanley Dubinski) qui vont du linguicide à l’utilisation d’un vocabulaire minorisant, comme celui utilisé pour évoquer l’histoire de la colonisation de l’Afrique. Sylvie Kandé prend ses distances avec ce discours pour évoquer cette histoire autrement. Par exemple, plutôt que de parler de « chef de village », elle parle de « baron ».
Territoire et nation
Pourquoi l’immigration, au fondement de l’histoire de l’humanité, est-elle traitée comme dangereuse pour le cadre national, qui lui-même est construit comme un territoire ? Achille Membé montre la façon dont le premier réflexe de la colonisation a été de figer le mouvement qui caractérise l’Afrique pré-coloniale. Sylvie Kandé rappelle qu’il existe d’autres modèles dans l’histoire. Le recueil La Quête de l’autre rive, comme le souligne Yolaine Parisot, constitue une « utopie » au sens premier du terme, l’esquisse d’une nouvelle cartographie. Sylvie Kandé y évoque en effet le Mali médiéval qui, du point de vue cartographique, constitue à la fois un repère historique et le point de départ contemporain de nombreux migrants. Elle rappelle que le Mali médiéval n’était pas une nation, mais une fédération sans langue commune, à laquelle on appartenait en payant un tribut et dont la capitale se déplaçait au gré des mouvements de l’Empereur. La première partie de La Quête de l’autre rive, intitulée « La Haute Mer », est consacrée à ces paysages particuliers, cette route des migrants, dans une volonté « d’historiciser l’océan », à l’invitation d’Edouard Glissant ou de Derek Walcott dans son poème « The Sea is History ».
La « démunition » dans laquelle arrivent les migrants s’avère créatrice, c’est ainsi « qu’ils enchantent » comme le dit Edouard Glissant. Il en est ainsi de la page blanche, décrite par Leopold Sedar Senghor comme « un moment de latence », plutôt que comme un problème. Les migrants sont les héros de la déterritorialisation, au sens que lui donnent Gilles Deleuze et Felix Guattari : la terre dépasse le territoire – elle est déterritorialisante et déterritorialisée. Elle se confond avec la migration.
Territoire, corps et pouvoir
À une question sur le corps comme territoire d’ouverture poétique, Sylvie Kandé se demande quelle est la différence entre l’appropriation d’un territoire et l’appropriation d’un corps, comme dans le cas du corps féminin assimilé à l’ennemi dans le cas du viol de guerre. Elle ajoute :
— Je m’interroge sur la métaphore du « corps-territoire » : c’est un lieu d’exercice du pouvoir qui est aussi, souvent, la base des retrouvailles avec la Terre. J’ai cependant une réserve sur cette métaphore et sa supposée portée émancipatrice […] Mon expérience personnelle passe dans mes écrits… Il me semble qu’il existe aujourd’hui un besoin de retour à l’unité. C’est pourquoi je me sens davantage proche de l’idée selon laquelle « les personnes dans la personne sont multiples dans la personne » (Amadou Hampâté Bâ) ou du proverbe sénégalais qui dit que le « moi » entretient une relation de codépendance à autrui ou encore que « l’homme est le médicament de l’homme« .
Sylvie Kandé constate que le Moi constitue aujourd’hui le dernier bastion de l’essentialisme. Sur le plan de la littérature, elle conçoit le texte littéraire non seulement comme un partage de sa pensée mais aussi de l’écriture comme processus. Ses textes apparaissent donc davantage comme un travail sur le métissage, comme un collage, un tissu de citations dont l’unité réside, au final, dans la lecture. Le rôle du lecteur est primordial dans la constitution du sens du texte qu’elle résume ainsi en clôture de son intervention : « Qu’est-ce qu’un auteur sans lecteur ? »
Au cours de son intervention, Sylvie Kandé a lu deux poèmes extraits de son recueil La quête infinie de l’autre rive, © Editions Gallimard, 2011.
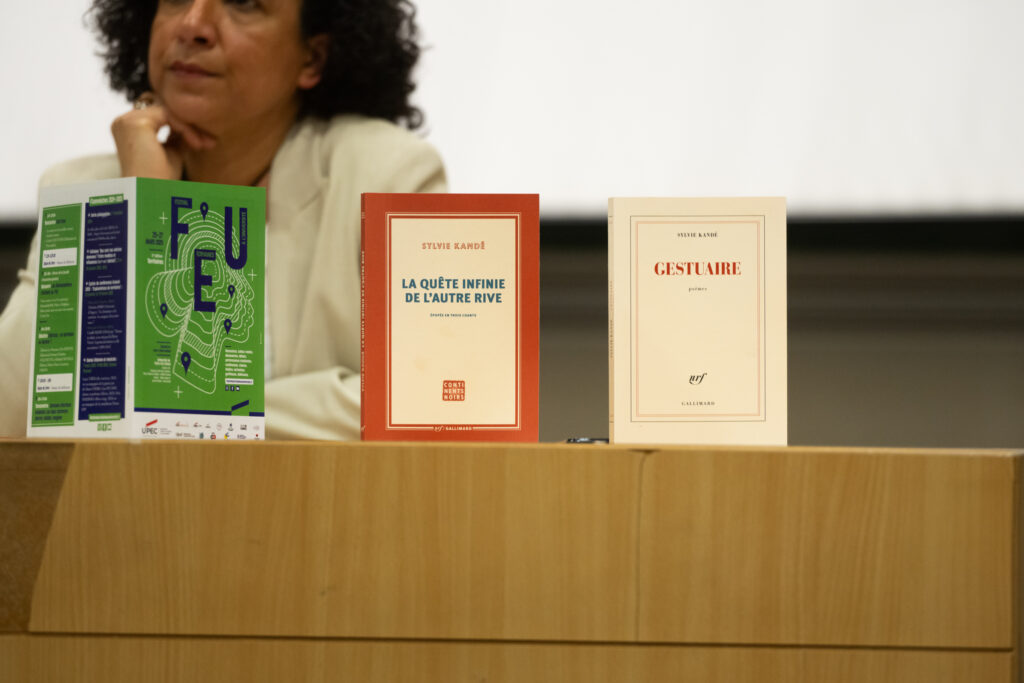
Chant I
Ils rament désormais sans chanson ni ahan
Depuis combien de temps…savoir… combien de saisons…
depuis combien d’îles-mirages apportées par les vents
ramaient-ils repus de roulis et gavés d’embruns…
Mémoire brouillée de ce-que-c’est-que-d’avoir-les-pieds-sur-terre
et paupières en chamade
ils ne se soucient plus à présent que de la vague qui va
se dérobe
et revient
Paysans qui sur le tard s’étaient faits marins
ils cadencent leurs corps
pour fendre de la pointe gâtée de l’aviron
les mottes violettes de la grande savane salée
que nul sillon ne marque
où nulle semence ne lève
(Mais à dire la mer peu siéraient les mots de la terre)
Au point de ce rêve
ils étaient une myriade
ni plus ni moins
qui passèrent en riant la barre de corail et ses fleurs vermeilles
n’en restent que trois barques en dérade
pleines mais pleines à chavirer
À pagayer leurs bras se sont faits pagaies
rivées dru à leurs torses noueux et bruns
et leurs pieds mangés de sel ne sont plus que moignons
qui ventousent au creux de la coque par le vif de sept plaies
Du vertige de leurs douleurs ils puisent encore la force de ramer :
oh le zèle hautain de ceux qui connaissent leur mort
approcher et préfèrent regarder au-delà du certain…
Chant III
À qui la faute si le poisson se fait rare
et nos multiples sorties d’autant plus vaines …
Les litanies des pêcheurs étaient interrompues
par les harangues de tardives commères
dont les ongles acerbes soupesaient l’exposé fretin
Tandis qu’elles reprochaient aux hommes
d’avoir démérité de la mer
tout à coup il me sembla à moi
fils d’un talent au rivage échoué
que du dédain de leurs doigts
elles m’écartaient l’ouïe
pour jauger de mon agonie
la douteuse fraîcheur
Poèmes reproduits avec l’aimable autorisation de son auteure et des Éditions Gallimard.
Festival des Femmes Ecrivaines à l’Université
Le Festival FEU est une manifestation scientifique, pédagogique et culturelle lancée en 2023 qui se déroule tous les ans fin mars à l’UPEC. Porté par Stéphanie Genand (LIS, UPEC), Claire Fourquet-Gracieux (LIS, UPEC) et Rossana de Angelis (CEDITEC, UPEC), FEU est un festival transdisciplinaire qui accueille écrivaines, intellectuelles, actrices du monde institutionnel et culturel dans l’enceinte de l’Université pour réfléchir autour d’un thème en lien avec l’écriture féminine. En amont du festival, le thème donne lieu à un travail avec les étudiants de Licence de Lettres de l’UPEC (cycle de conférences, soirées littéraires, atelier d’écriture) et se déroule en partenariat avec la Maison des Arts de Créteil (MAC), le Cinéma du Palais, la Bibliothèque de l’Arsenal ou la librairie Envie de Lire (Ivry-sur-Seine).
Le Moi est le dernier bastion de l’essentialisme.
À propos de l’auteur de cet article
Murielle Vauthier, doctorante (LIS-UPEC) & Manager de l’EUR FRAPP
Ses recherches portent sur le « pouvoir germinatif » de la fiction transnationale chez Doris Lessing, Edouard Glissant et une sélection d’auteures contemporaines.
Site de Sylvie Kandé : https://www.sylviekande.com/
Sélection bibliographique
Lagon, lagunes. Tableau de mémoire. Avec une postface de l’écrivain martiniquais Édouard Glissant). Collection Continents Noirs, Gallimard, Paris 2000.
La quête infinie de l’autre rive. Épopée en trois chants. Collection Continents Noirs. Gallimard, Paris 2011 (Finaliste pour le Prix Mahogany et le Prix des Découvreurs. Prix Lucienne Gracia-Vincent en 2017).
Gestuaire, poèmes. Collection Blanche. Gallimard, Paris 2016. (Prix Louise-Labé en 2017 finaliste du Prix Éthiophile en 2018) Essais
Terres, urbanisme et architecture “créoles” en Sierra Leone (18ème-19ème siècles). L’Harmattan, 1998
Discours sur le métissage, identités métisses. En quête d’Ariel (Actes de la conférence organisée à l’Université d’État de New York sur le métissage, direction d’ouvrage). L’Harmattan, 1999
Références citées
Stanley Dubinsky and Harvey Starr. « Weaponizing Language: Linguistic Vectors of Ethnic Oppression. » Global Studies Quarterly 2.2 (2022) ksab051.
Gilles Deleuze, Felix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ? Paris : Editions de Minuit, coll. « Reprise », 2005
Edouard Glissant, L’intention poétique. Poétique II. Paris : Gallimard, coll. « Blanche », 1997
– Introduction à une poétique du divers. Paris, Gallimard, coll. « Blanche », 1996
Amadou Hampâté Bâ, « La notion de personne en Afrique Noire » dans le cadre du Colloque International sur La Notion de personne en Afrique Noire (Paris, 11 au 17 octobre 1971)
Achille Membé, Sortir de la grande nuit. Essai sur l’Afrique décolonisée. Paris : La Découverte, 2010.
Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Paris : Poche, 2024
Leopold Sedar Senghor, La poésie de l’action. Conversation avec Mohamed Aziza. Paris: Stock, coll. « Grands leaders », 1980
Derek Walcott, Une autre vie. Traduit par Claire Malroux. Paris : Gallimard, 2002
– Ormeros. MMIT Publishing, 2018
En savoir plus sur le Festival Femmes Ecrivaines à l’Université:
Site du Festival FEU : https://www.festivalecrivainesuniversite.fr/