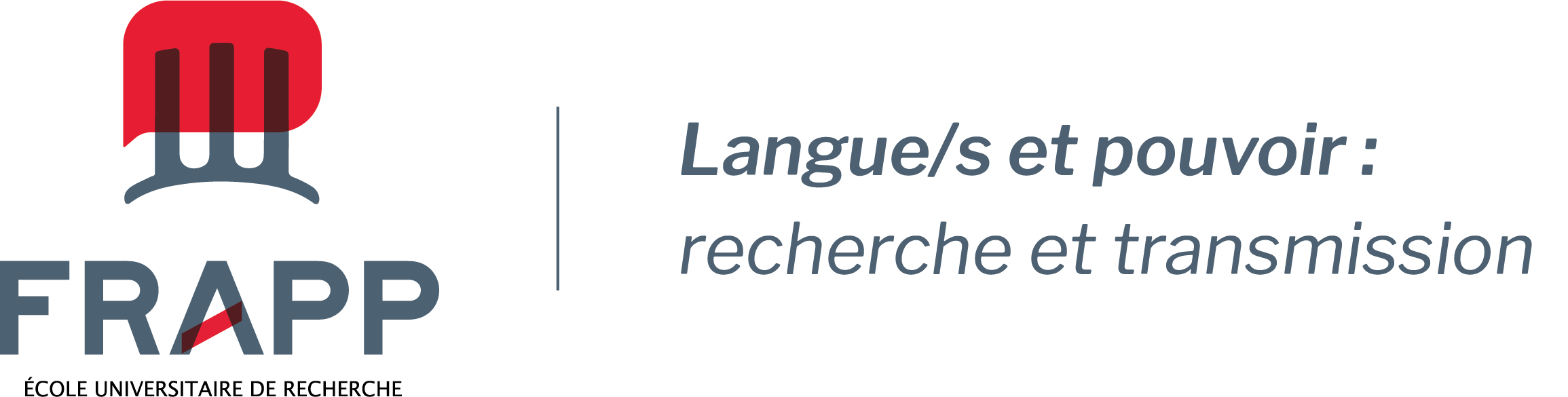Le 16 janvier dernier, les étudiant.es et doctorant.es de l’EUR FRAPP ont eu le plaisir de rencontrer Souleymane Bachir Diagne, Professeur de philosophie à l’Université de Columbia. Il est revenu, pour eux, pendant plus de deux heures, sur ses deux derniers ouvrages parus en 2024, Universaliser. L’humanité par les moyens d’humanité et Ubuntu. Entretien avec Françoise Blum. Ils s’inscrivent dans la continuité de son travail de recherche que Souleymane Bachir Diagne envisage comme une contribution « à la présence africaine en philosophie […] dans la formulation de toutes les grandes questions qui sont celles de l’humanité ».
Nous reproduisons, dans les propos qui suivent et avec l’aimable autorisation de son auteur, les réponses de Souleymane Bachir Diagne à nos questions qui portaient en particulier sur la circulation des concepts entre les langues.
De l’universalisme latéral à universaliser
L’humanité par les moyens d’humanité fait suite à un séminaire que j’ai donné à l’Ecole Normale de la Rue d’Ulm [séminaire « De l’Universel » donné entre le 7 février et le 18 avril 2023]. Les conversations avec les étudiants m’ont conduit à adopter ce verbe, Universaliser.
Avant cela, je parlais d’un concept tiré du philosophe Maurice Merleau-Ponty qui avait parlé de l’opposition entre un universel de surplomb et de ce qu’il avait appelé un « universel latéral », ou « horizontal » ou « oblique ». On trouve les trois adjectifs dans son œuvre. L’idée sous-jacente est que nous vivons désormais une époque où l’universel ne saurait devoir son existence à la verticalité d’une culture particulière, comme celle de l’Europe, qui lui donne la mission d’universaliser le reste du monde. Merleau-Ponty disait qu’il nous faut penser désormais, quand il s’agit de l’universel, sur un plan d’égalité et d’équivalence parfaite entre toutes les cultures et toutes les langues du monde. Il invitait donc à penser un nouvel universel, qui serait un universel de traduction, dont un modèle est la rencontre entre des langues différentes.
Universaliser comme pratique
Il m’a semblé qu’il fallait davantage préciser les choses et dire que « l’universel latéral » n’est pas un nouvel objet à définir mais une exigence à mettre en œuvre, en pratique dans le dialogue et la négociation. Ce n’est pas un processus simple mais c’est ce que nous avons pour faire en sorte d’être tous présents, toutes les cultures du monde, dans cette pratique d’universalisation.
C’est pourquoi il nous faut cultiver la capacité de décentrement nécessaire à une inscription dans le pluriel du monde, Donc d’abord comprendre que le monde est pluriel et qu’il est bon qu’il en soit ainsi. Ces pratiques d’universalisation vont se forger dans le dialogue : ainsi, le latéralisme de l’universel, sur le plan philosophique, essaie de se traduire concrètement dans le multilatéralisme diplomatique (par exemple, la Déclaration universelle des droits de l’Homme ; les COP) avec toutes les difficultés qui lui sont liées.
[…] Au dialogue s’ajoute l’idée que les savoirs n’existent que dans le processus de traduction et dans l’hétéroglossie. C’est la leçon de l’histoire. L’oublier, c’est avoir une conception identitariste des savoirs. L’hétéroglossie est importante pour penser « de langue à langue », pour reprendre le titre d’un de mes ouvrages.
Ubuntu, fabrique d’un concept philosophique
J’insiste sur la banalité totale de ce mot. Il n’a rien de particulier au départ. Un philosophe africain rwandais important qu’il serait bon de redécouvrir, Alexis Kagame, a écrit en 1956 un livre très important, La philosophie bantu-rwandaise de l’être. Il y réfléchit à la relation entre la philosophie et les langues. Il explique la construction des mots bantous avec une approche de linguiste tout à fait éclairante et remarque, à propos d’Ubuntu, que c’est un terme abstrait construit à partir du terme concret, « buntu » et l’ajout du préfixe « U ». Buntu est le pluriel de muntu et signifie « les humains ». Cependant, Ubuntu ne signifie pas humanité au sens de l’ensemble des humains, mais également le fait d’être humain, humanness en anglais. L’anglais permet de distinguer humanity et humanness, contrairement au français. Alexis Kagame explique qu’Ubuntu renvoie à la signification morale et éthique de ce qu’est être humain. Il en reste là car, pour lui, Ubuntu n’a pas d’importance particulière.
En revanche, la situation d’apartheid en Afrique du Sud a donné à Ubuntu une signification particulière, le sortant de sa banalité pour le construire comme concept philosophique.
Dans Qu’est-ce que la philosophie ? Deleuze et Guattari définissent l’activité philosophique comme le fait de construire des concepts : cela veut dire prendre un mot de la langue que nous parlons et le construire philosophiquement en vue de répondre à une situation qu’il permet de formuler et analyser plus avant.
L’apartheid considère qu’il y a, non pas une humanité mais des humanités existant ensemble dans une simple juxtaposition. L’apartheid, avant d’être un racisme et une doctrine de l’inégalité, est d’abord une doctrine de la séparation, l’idée que les cultures humaines ne peuvent prospérer que si elles ne se mélangent pas. La construction même du mot signifie simplement être à part, être séparé. Ubuntu est un concept construit contre l’idée qu’il existe uniquement des humanités séparées et que parler d’humanité au singulier est une pure sommation zoologique.
Ubuntu ou l’humanité comme projet à réaliser
Ubuntu renvoie à deux choses : d’abord, l’idée qu’être ‘humain n’est pas un état, c’est avoir la responsabilité et la tâche de réaliser pleinement sa propre humanité ; ensuite, l’idée que mon humanité se construit dans la réciprocité avec les autres.
Il s’agissait par conséquent de construire le concept Ubuntu comme un concept philosophique et politique pour sortir de la logique de l’apartheid autrement que par le cycle de la vengeance. Comme tel, il a été mis en œuvre par Nelson Mandela et Desmond Tutu, en particulier avec la Commission Vérité et Réconciliation. Ubuntu est devenu une leçon d’humanisme pour le monde entier, c’est- à-dire que la mondialisation du concept aujourd’hui est une leçon d’humanisme portée par l’Afrique du Sud pour le reste du monde. C’est cela la signification d’un concept philosophique qui se construit dans l’hétéroglossie. Desmond Tutu a dit qu’il était très difficile de traduire Ubuntu dans une langue occidentale – il est toujours très difficile de traduire quoi que ce soit dans une autre langue : une langue, c’est une certaine relation au monde, on pourrait même dire que rien n’est traduisible de ce point de vue-là, mais la traduction s’effectue toujours, c’est cela, construire ce concept et lui donner une validité universelle.
Au-delà de l’Afrique du Sud, Ubuntu est devenu un concept de ce qu’on appelle aujourd’hui justice transitionnelle : l’idée que certaines situations invitent à penser la justice d’une autre manière, en rapport au futur que l’on veut créer et non en rapport au passé. S’il nous faut créer une nation à partir de la fragmentation en tribus, alors il est important que nos actions soient dictées par la nation que nous avons en vue et donc portées par l’impératif de réconciliation. Il y a des situations où c’est la seule solution possible. La situation de l’Afrique du Sud post-apartheid en a été une, la situation du Rwanda post-génocide également.
Prenons les décisions qu’il faut en fonction de la nécessité où nous sommes de réapprendre à vivre ensemble, de faire Ubuntu. Ubuntu n’est pas un projet naïf, c’est un combat, difficile, parce qu’il faut surmonter les inégalités, le crime, le meurtre, la souffrance, qui nous empêchent de faire humanité ensemble.
Voilà ce que signifie construire ce concept, mettre en avant le premier universel qui est l’humanité. C’est la raison pour laquelle j’ai choisi pour sous-titre de mon livre « Universaliser. L’humanité par les moyens d’humanité » cette citation de Jean Jaurès qui invite à aller à l’humanité par des moyens d’humanité. »
Universaliser n’est pas un nouvel objet à définir mais une exigence à mettre en œuvre.
À propos de l’auteur de cet article
Murielle Vauthier, doctorante (LIS-UPEC) & Manager de l’EUR FRAPP
Références bibliographiques
Souleymane Bachir Diagne, Universaliser. L’humanité par les moyens d’humanité. Paris : Albin Michel, coll. « Bibliothèque Idées », 2024
- Ubuntu. Entretien avec Françoise Blum. Préface de Barbara Cassin. Paris : Editions de l’EHESS, 2024
- De langue à langue. L’hospitalité de la traduction. Paris : Albin Michel, coll. « Bibliothèque Idées », 2018
- Séminaire « De l’Universel » donné à l’ENS de la Rue d’ULM DU du 7 février au 18 avril 2023 (accès libre)
Lien et ressources
Souleymane Bachir Diagne, philosophe d’études francophones et de philosophie, Université de Columbia
Références citées :
Gilles Deleuze, Felix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ? Paris : Editions de Minuit, coll. « Reprise », 2005
Alexis Kagame, La philosophie bantu-rwandaise de l’être, Bruxelles : Mémoire de l’Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer vol. XII, 1956.
Maurice-Merleau Ponty, 2008, « Rapport de Maurice Merleau-Ponty pour la création d’une chaire d’Anthropologie sociale », La Lettre du Collège de France, Hors-Série, 2 : 49-53.
Immanuel Wallerstein, L’universalisme européen. De la colonisation au droit d’ingérence. Traduction Patrick Hutchinson. Demopolis, 2008.